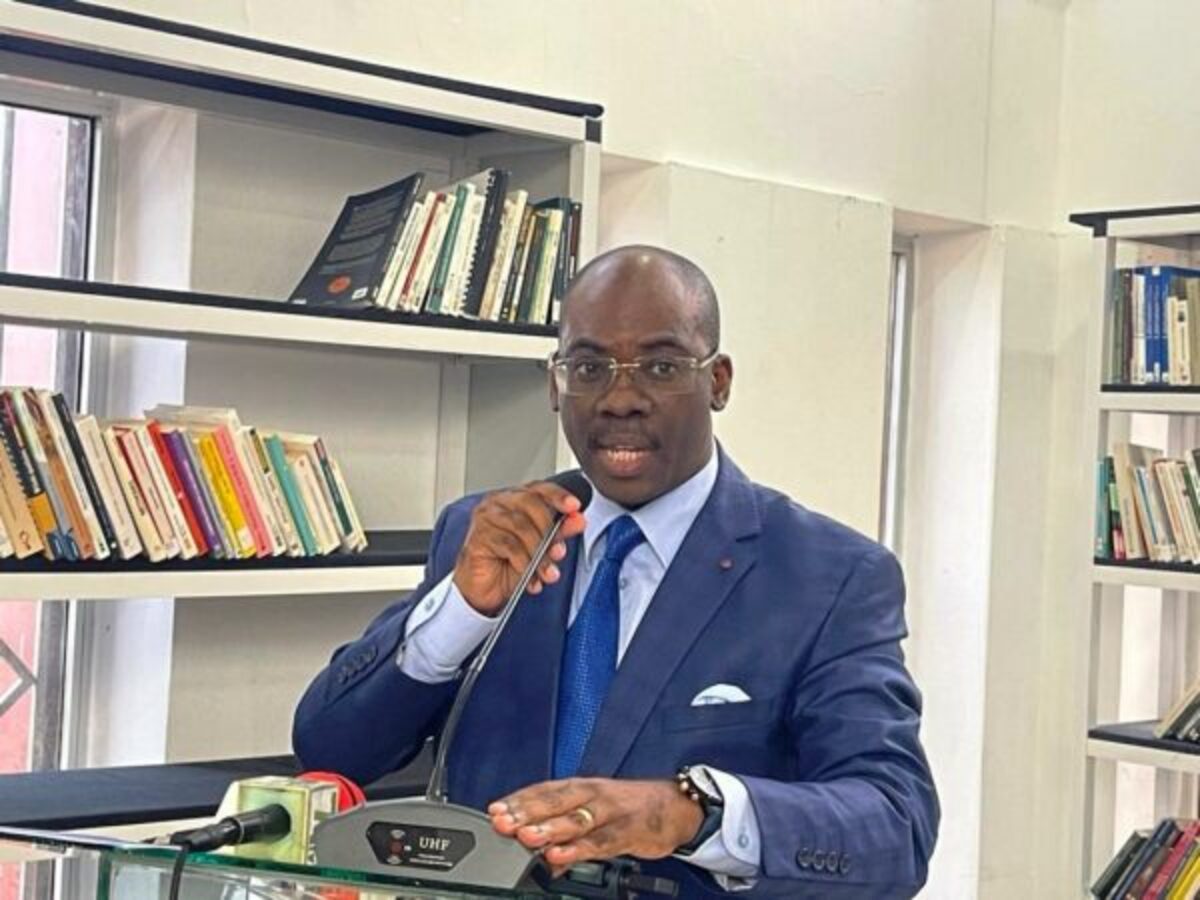En Algérie, les autorités annoncent des résultats chiffrés impressionnants contre la corruption. L’Office central de répression de la corruption (OCRC) a mené des enquêtes financières sur 288 personnes entre 2024 et 2025, aboutissant à la découverte de biens d’une valeur totale de 24 milliards de dinars, soit environ 130 millions d’euros.
Des sommes qui révèlent l’ampleur des détournements, mais aussi l’inefficacité d’un système où les procédures se multiplient sans qu’on en connaisse vraiment l’aboutissement.
L’OCRC ne chôme pas. Entre 2024 et 2025, l’office a conduit 1 297 missions d’enquête, dont 629 rien que sur l’année 2025, et 35 commissions rogatoires, impliquant 552 personnes auditionnées.

Des chiffres qui donnent le vertige. Mais pour quel résultat concret ? L’activisme administratif ne manque pas, certes. Reste que cette accumulation de dossiers pose une question : combien aboutissent réellement à des condamnations ? La réponse demeure floue.
Les scandales financiers éclatent régulièrement. Entreprises publiques, appels d’offres truqués, gestion opaque des fonds locaux : la corruption traverse tous les échelons de l’administration.
Elle ne se limite pas à quelques cas isolés. Sur les 24 milliards de dinars de biens découverts, 13 milliards ont été saisis en 2025. Un montant qui dit tout de l’enracinement du phénomène dans les structures publiques.
Bref, les mécanismes de contrôle existent pourtant : l’OCRC, la Cour des comptes, l’Inspection générale des finances. Tous produisent des rapports, lancent des investigations.
Mais la chaîne de responsabilité reste verrouillée par des jeux politiques qui limitent la portée des sanctions. Les enquêtes paraissent souvent sélectives. Elles visent des responsables tombés en disgrâce ou des acteurs secondaires, pendant que les vrais réseaux de pouvoir échappent aux poursuites.
Les autorités se félicitent pourtant de leurs performances. L’OCRC prévoit une hausse de 26 % de ses activités d’enquête pour 2026. Une intensification qui ne s’accompagne d’aucune transparence sur les jugements rendus, les fonds restitués, les montants rapatriés. Cette opacité nourrit la méfiance. Pour beaucoup d’Algériens, la lutte anticorruption ressemble davantage à un instrument politique qu’à un véritable mécanisme d’assainissement.
Les bilans communiqués ne manquent pas d’ampleur. Mais sans publication des condamnations effectives, sans suivi des restitutions, difficile de mesurer l’efficacité réelle du dispositif. Les chiffres impressionnent. Les résultats tangibles, eux, se font attendre.